
Couleur Café :
- Peuplement de la
Guadeloupe
-Généalogie Renoir
-Métissage
- sur les traces des ancêtres
-visite de la Grivelière
-L'église Saint Joseph HD des photos
Ce n’est qu’après 4 kilomètres qu’un parking rudimentaire annonce l’entrée de la propriété.
 De
là, la beauté de la vallée peut être
admirée, on est en plein parc national ! Au fond de cette
vallée encaissée coule la grande rivière.
De
là, la beauté de la vallée peut être
admirée, on est en plein parc national ! Au fond de cette
vallée encaissée coule la grande rivière.Une rude pente empierrée mène à la propriété et aux bâtiments d’exploitation.

On peut imaginer combien la vie était rude au 18° et au 19° siècle, pour les esclaves bien sûr mais aussi pour les maitres, au fond de cette vallée difficile d’accès, dans cette forêt dense et humide !
Les bâtiments essentiellement en bois remonte au début du 19° siècle.
 Dès
l’arrivée un bâtiment retient notre attention,
plutôt deux corps de bâtiment séparé par une
roue à eau
Dès
l’arrivée un bâtiment retient notre attention,
plutôt deux corps de bâtiment séparé par une
roue à eaualimentée par une dérivation la ravine Pagesy qui utilise les fortes pentes.
 Cette
roue à aube, entrainait une machinerie conçue par Auguste
Periollat qui était utilisée pendant la seconde
moitié du 19° siècle pour la fabrication du roucou :
elle réduisait en pâte marchande les graines
écossées en les broyant. Le roucou est une plante dont
les graines ont des vertus colorantes et anti inflammatoire.
C’était utilisé comme cosmétique par les
indiens guyanais. Le bâtiment est en bois construit sur une
semelle en pierres de lave.
Cette
roue à aube, entrainait une machinerie conçue par Auguste
Periollat qui était utilisée pendant la seconde
moitié du 19° siècle pour la fabrication du roucou :
elle réduisait en pâte marchande les graines
écossées en les broyant. Le roucou est une plante dont
les graines ont des vertus colorantes et anti inflammatoire.
C’était utilisé comme cosmétique par les
indiens guyanais. Le bâtiment est en bois construit sur une
semelle en pierres de lave.C’est l’arabica linné qui pousse en Guadeloupe originaire des monts d’Abyssinie.
A l’état naturel c’est un arbuste de 5 à 6 mètres de hauteur, il est écimé pour faciliter la cueillette des cerises. Les arbustes ont besoin d’une protection contre le soleil et les vents, d’où sa culture en forêt tropicale sur la côte abritée du vent. Il exige des températures entre 17 et 23° sans écart importants et des pluies abondantes entre 1500 à 2000mm sur 8 mois. Il se plait aussi dans les terres volcaniques riches en humus à des altitudes entre 200 et 500 mètres. Les caféiers produisent leurs premiers fruits 4/5 ans après le semis.
 Les
fruits sont verts puis jaunes enfin rouges vifs, ils possèdent
deux loges pulpeuses séparés qui renferment chacune un
graine. La peau doit être éliminée, qu’on
laisse fermenter la graine encore entourée de sa pulpe.
Puis les graines sont lavées et mises à
sécher dans de grands tiroirs sur rails que l’on rentre
sous le « Boucan » en cas de pluie.
Les
fruits sont verts puis jaunes enfin rouges vifs, ils possèdent
deux loges pulpeuses séparés qui renferment chacune un
graine. La peau doit être éliminée, qu’on
laisse fermenter la graine encore entourée de sa pulpe.
Puis les graines sont lavées et mises à
sécher dans de grands tiroirs sur rails que l’on rentre
sous le « Boucan » en cas de pluie. Une fois secs, on ôte la dernière peau appelée « parche » puis les grains de café sont de nouveau séchés avant la torréfaction et la mise en sachet.

Un petit oratoire rappelle qu’elle était en 1761 la propriété des Frères Jacolins et s’appelait alors « Caféière Saint Joseph » Elle devint en 1843 avec Auguste Périollat « la Grivelière ».
La maison du Maitre a été restaurée en 1999. Les cloisons intérieures sont en acajou, la couverture en essentes.




La visite se termine par une dégustation, du café bien sûr ou un délicieux chodo.
pour quitter choisissez l'un de nos themes :
les
loisirs : 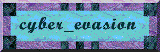 les voyages :
les voyages :  le
club video :
le
club video : 